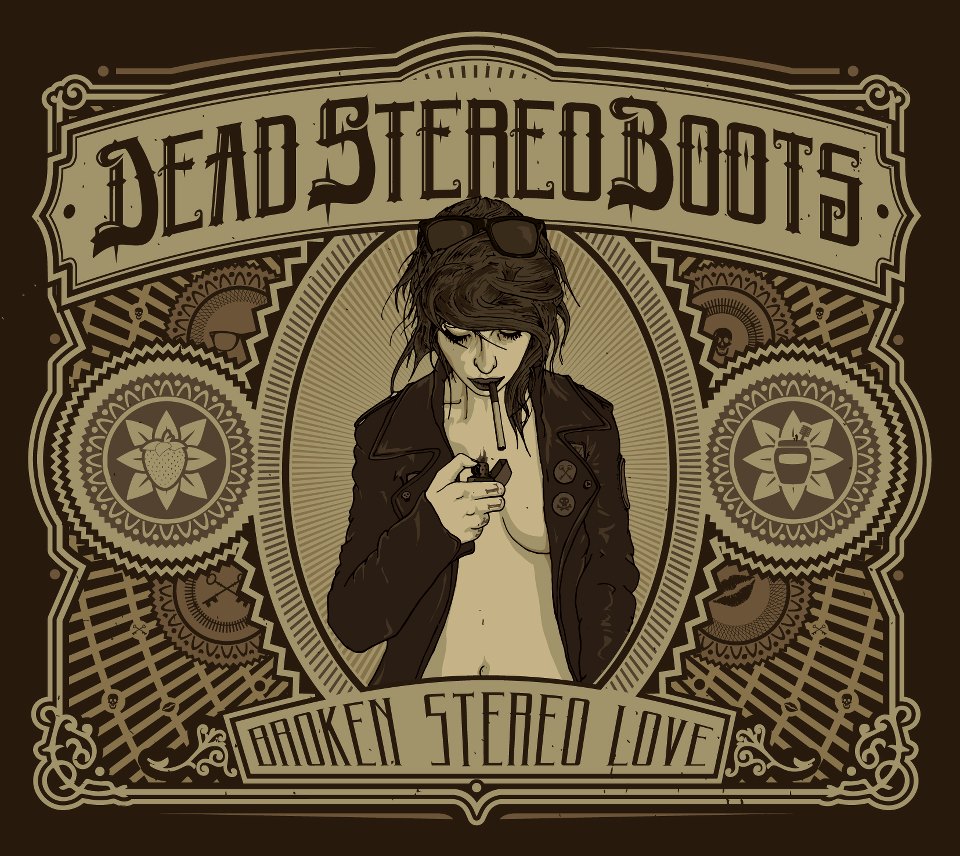Whiplash, sorti le 24 décembre dernier, est le deuxième long métrage du jeune (tout juste 30 ans) Américain Damien Chazelle, après Guy and Madeline on a Park Bench en 2009, inédit en France. Il nous propose ici une troublante plongée dans la vie d’Andrew (Miles Teller), un jeune batteur de jazz qui parvient à intégrer le conservatoire de Manhattan, présenté comme le plus prestigieux des États-Unis. Dans sa quête éperdue pour devenir le meilleur, il se frotte à Terence Fletcher (J. K. Simmons), un professeur réputé mais despotique.
Sur ce canevas aux allures de Karaté Kid musical, le réalisateur préfère tisser un violent huis clos sur la passion pour la musique comme obsession à attiser. Pour Andrew, toutes les choses qui l’entourent semblent résonner comme une batterie. Il a ça dans le sang et sait qu’il ne veut rien faire d’autre. Bizarrement, quelque chose en lui semble persuadé que son talent ne suffit pas pour réussir, que seul l’affrontement de multiples obstacles lui permettra d’accéder à la gloire et à la reconnaissance.
Ainsi, sa rencontre avec Fletcher, dès la scène d’introduction, résonne d’emblée pour lui comme une aubaine, alors qu’elle dégoûterait la plupart des gens. Le professeur, craint de tous, vient s’intéresser quelques instants au coup de baguette d’Andrew, mais quitte vite la pièce, blasé. Il lui joue alors un tour de très mauvais goût : il passe à nouveau la porte et s’approche du batteur, mais seulement pour reprendre son manteau et repartir aussi sec… Les dés sont jetés. Comme s’il n’attendait que ça, Andrew décide de s’engouffrer dans une relation d’apprentissage sado-masochiste avec ce tortionnaire.
Formellement, la mise en scène de Damien Chazelle est d’une efficacité redoutable : le spectateur est happé tout entier par les gros plans immersifs, le montage syncopé coulant parfaitement sur la musique et le recours régulier à une courte profondeur de champ isolant les personnages de leur environnement. Cette intensité visuelle est redoublée par la bande son, des morceaux composés pour le film par Justin Hurwitz – que le réalisateur a rencontré sur les bancs de Harvard lors de ses études – et Tim Simonec. Batterie (forcément), trompettes et piano rivalisent de virtuosité sur d’irrésistibles rythmes de jazz. Pourtant répétés jusqu’à la nausée, les morceaux révèlent une résistance à toutes épreuves en ne parvenant jamais à lasser l’auditeur. Comme Andrew, on en redemande.
Sang, sueur, abrutissantes répétitions des mêmes gestes, plaies physiques et morales : le duel entre l’élève et son mentor relève bien plus du combat de boxe, voire du chemin de croix, que du récit initiatique classique et propret qui caractérise la plupart des films musicaux. Cette ampleur et cette gravité, qui confinent d’ailleurs parfois à l’exagération, résultent sans doute du fait qu’il s’agit d’un récit partiellement autobiographique : le réalisateur a lui-même pratiqué la batterie pendant plusieurs années au conservatoire et avoue avoir été terrorisé par son chef d’orchestre.
Crédit photo : Ad Vitam
Andrew, comme l’a sûrement été Damien Chazelle, est tiraillé entre tous ses désirs. C’est d’ailleurs la plus grande réussite du film que de rendre compte avec autant de justesse des contradictions existant dans son for intérieur. Sa relation avec son père, quasi muette mais débordante d’amour ; sa rencontre amoureuse avec une fille aux aspirations bien différentes mais pourtant pétrie des mêmes doutes que lui… Le jeune batteur a la rage de vaincre, mais il n’est pas sûr de vouloir sacrifier sa vie pour sa passion. « Fuck it ! », lui crie alors Fletcher.
Curieusement, après cette passionnante réflexion sur la place à accorder à chaque chose, le cinéaste – qui a pourtant lui-même abandonné la batterie pour se tourner vers le cinéma – change son fusil d’épaule dans la dernière partie du film. Si jusque-là, il plaçait les méthodes scandaleuses et humiliantes du professeur dans sa ligne de mire, une scène de discussion d’ « égal à égal » entre Andrew et Fletcher, alors que celui-ci est presque au tapis, vient redéfinir les règles. Le prof explique que, durant toute sa carrière, son odieux comportement n’a servi qu’un seul but : dénicher un nouveau génie de la musique, celui qui saura résister à n’importe quelle attaque, encaisser tous les coups et se relever quoi qu’il arrive, précisément parce qu’il est obsédé par son art.
Après cette justification plus effrayante encore que tous les comportements qu’il a eu jusque-là, le professeur fou s’engage dans un dernier bras de fer avec Andrew, plus consentant que jamais. Dans un final orgiaque, Damien Chazelle magnifie ses deux protagonistes en les montrant comme deux dieux luttant maintenant l’un pour l’autre, dans un échange intense et lourdement sexualisé. L’esbroufe visuelle mise de côté, on peut aussi ne plus voir dans cette longue scène que deux hommes solitaires qui s’enferment dans une relation d’autosuffisance malsaine.
Bien d’autres chemins que cette conclusion, parfaitement raccord avec le mythe du rêve américain tel qu’il est encore perçu aujourd’hui, s’offraient au réalisateur. À une proposition nouvelle, plus audacieuse et humaine, pour vivre sa passion pour la musique, il a préféré la représentation stéréotypée d’un jeune prodige obligé de s’imposer par la force et la souffrance pour accomplir son rêve. Reste cette mise en scène implacable, que l’on ne peut malheureusement plus s’empêcher d’assimiler rétrospectivement à la ridicule démonstration de puissance d’Andrew dans la scène finale.
Texte : Timé Zoppé
La bande originale est en écoute sur Deezer.